3e4 Projet voyage Auschwitz
I. La formation des ghettos
Pourquoi et comment les ghettos ont-ils été créés lors de la seconde guerre mondiale ?
INTRODUCTION:
Le mot "ghetto" provient du nom du quartier juif de Venise, créé en 1516, dans lequel les autorités vénitiennes avaient obligé les Juifs de la ville à vivre. Aux XVI et XVIIème siècles, de nombreux dirigeants (qui allaient des autorités municipales locales jusqu'à l'empereur d'Autriche Charles V) ordonnèrent la création de ghettos pour les Juifs, à Frankfort, Rome, Prague et dans d'autres villes. Les ghettos ont été créés par les nazis lors de la seconde guerre mondiale suite à l’envahissement de la Pologne. Ils vont s’en servir pour parquer les juifs, les exclure du reste de leur ville avant de les envoyer dans les centres de mise à mort. Le premier ghetto est mis en place le 8 octobre 1939 à Piotrkow. Il est suivi par celui de Lodz (avril 1940) puis de Cracovie (mars 1941), Varsovie (octobre 1940), et Lublin (avril 1941). Fin 1941, presque tous les Juifs du Gouvernement général sont parqués dans des ghettos dont les accès sont contrôlés par les forces allemandes et dont il est presque impossible de sortir.

Carte postale allemande montrant l’entrée du ghetto de Lodz. La pancarte dit “Zone de résidence juive - entrée interdite.” Lodz, Pologne, 1940-1941.
A. La présentation des ghettos
Pendant la seconde guerre mondiale, les ghettos étaient des quartiers isolés du reste du tissu urbain, souvent clôturés, dans lesquels les Allemands concentraient la population juive de la ville, parfois de la région, et l'obligeaient à vivre dans des conditions misérables. Au moins 1 000 ghettos furent crées dans les seules Pologne et Union soviétique. Le premier ghetto fut établi par les autorités d'occupation allemande en Pologne, à Piotrków Trybunalski, en octobre 1939.
Le plus grand ghetto de Pologne fut celui de Varsovie, dans lequel plus de 400 000 Juifs furent entassés sur une superficie d'environ 3.3 kilomètres carrés. Les autres principaux ghettos furent ceux de Lodz, Cracovie, Bialystok, Lvov, Lublin, Vilno, Kovno, Czestochowa et Minsk. Des dizaines de milliers de Juifs d'Europe occidentale furent également déportés dans des ghettos à l'Est.
Les Allemands voyaient la création des ghettos comme une mesure provisoire de contrôle et de ségrégation des Juifs alors que les dirigeants nazis à Berlin délibéraient des différentes options qui leur permettraient d'atteindre leur objectif d'élimination de la population juive. Dans de nombreux endroits, la ghettoïsation dura relativement peu de temps: certains ghettos n'existèrent que quelques jours, d'autres des mois ou des années. Avec la mise en œuvre de la "Solution finale" (le plan visant à mettre à mort tous les Juifs européens) à la fin de 1941, les Allemands détruisirent systématiquement les ghettos. Avec leurs auxiliaires, ils fusillèrent les résidents dans des fosses communes situées à proximité ou les déportèrent, généralement par train, dans des centres de mise à mort pour y être assassinés. Une faible minorité fut déportée dans les camps de travail forcé ou les camps de concentration.

Bombardement de Varsovie
01/12/1939 : Varsovie capitule le 27 septembre 1939. 350 000 Juifs vont être la proie des autorités allemandes qui vont leur assigner des quartiers réservés.

C. La résistance
Les Juifs répondirent aux restrictions du ghetto par de nombreuses formes de résistance. Ils se livrèrent fréquemment à des activités considérées comme illégales, la plupart du temps sans en informer les conseils juifs ou recueillir leur accord, en faisant entrer clandestinement de la nourriture, de médicaments, d'armes, ainsi que des informations, de l'extérieur des murs du ghetto. Certains conseils juifs, ainsi que certains membres des conseils, tolérèrent ou encouragèrent ce commerce illicite, jugeant les marchandises nécessaires au maintien en vie des habitants. Si les Allemands se montraient d'une manière générale peu inquiets de la participation des habitants au culte religieux, aux événements culturels ou aux mouvements de jeunesse à l'intérieur du ghetto, ils percevaient souvent tout mouvement social comme "une menace à la sécurité" et intervenaient alors impitoyablement pour incarcérer ou tuer les "meneurs" présumés et les participants. Toute forme de scolarisation ou d'éducation organisée était généralement interdite.
Dans certains ghettos, les membres de la résistance juive organisèrent des soulèvements armés. Le plus important fut le soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943. Il y eut aussi des révoltes violentes à Vilno, Bialystok, Czestochowa, et dans plusieurs autres ghettos plus petits. En août 1944, les nazis achevèrent la destruction du dernier grand ghetto, celui de Lodz.
B. La vie dans les ghettos
Les Juifs des ghettos étaient contraints de porter des insignes ou des brassards afin de s'identifier et beaucoup furent soumis au travail forcé au profit du Reich allemand. Les ordres des autorités allemandes étaient appliqués par les Judenraats ou Conseils juifs, y compris la facilitation des déportations vers les centres de mises a mort. Les responsables juifs étaient à la merci des Allemands. La vie quotidienne est très difficile.
Des milliers de juifs sont entassés dans les ghettos, parfois 15 personnes habitent une même pièce. Tout juif trouvé hors du ghetto, par exemple s’il voulait tenter de s’enfuir, est exécuté sur place. Les réunions religieuses sont strictement interdites. Les juifs sont dans l’obligation de cacher de la nourriture car les allemands ne leur donne une portion de nourriture misérable. Les juifs ont peur des allemands qui circulent dans le ghetto car il n’hésite pas à battre les juifs parfois jusqu’à la mort ou à les humilier…

Deux combattants juifs sont pris dans les ruines du ghetto.
CONCLUSION:
Les Allemands présentèrent la création des ghettos comme une mesure provisoire de contrôle et de séparation des juifs. Ils ont servi d’intermédiaire entre le début des persécutions juives et les centres d’extermination. Avec la mise en œuvre de "la solution finale", les ghettos furent progressivement vidés par les allemands en 1942, pour déporter les juifs vers les centres d’extermination.
Bilan:
800 000 juifs ont trouvés la mort dans les ghettos, soit 15% de tous les victimes juives du génocide pendant la seconde guerre mondial.
II. Le ghetto de Varsovie
INTRODUCTION:
En mai 1940, le quartier juif de Varsovie est officiellement déclaré par les Allemands « zone d’épidémie » et le 2 octobre 1940, le gouverneur du district de Varsovie, Ludwig Fischer, publie l’ordre de transplantation : entre le 12 octobre et le 31 novembre 1940, 113 000 non-Juifs quittent le quartier juif et 138 000 Juifs y « déménagent » dans un climat de panique.
Clos le 16 novembre 1940, le ghetto de Varsovie est en partie cerné d’un mur d’enceinte
Le ghetto a une superficie de 300 hectares avec 128 00 habitants dont 121 265 habitants qui sont soumis au travail forcés. Sur ces 128 000 habitants, entre 10% et 15 % enfants sont orphelins. En mai 1942 le ghetto compte environ 400 000 habitants. La ration quotidienne est de 2 613 calories pour un allemand de Varsovie, 699 calories pour un polonais et 184 calories pour un juif, soit 15% du minimum vitale. Dès l’automne 1939, commencent les persécutions antijuives dans le gouvernement général. À partir du 1er décembre 1939, tous les Juifs âgés de plus de douze ans doivent arborer un brassard blanc où figure une étoile de David bleue. D’autres mesures, prises au cours de l’automne et de l’hiver 1939-1940, visent à isoler et à brimer : couvre-feu, interdiction de changer de domicile, de voyager en chemin de fer, confiscation des postes de radio, interruption fréquente de la distribution du courrier, interdiction de fréquenter les jardins publics, etc.
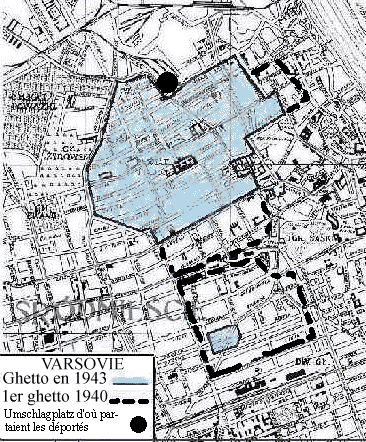
Le ghetto de Varsovie est au centre de Varsovie. Il était plus grand au début et formé de deux parties reliées par un pont :

La passerelle reliant les deux parties du ghetto : le petit ghetto et le grand ghetto
Les Allemands ne paieront jamais ces travailleurs. C’est la communauté juive elle-même qui les rémunère (3 zlotys par jour). Fin 1939, 28 camps de travail sont installés dans la région marécageuse de Lublin, et 14 dans la zone de la capitale. À l’été 1940, 107 000 Juifs de Varsovie travaillent pour les Allemands comme des quasi esclaves. Par ailleurs, les patrons allemands se voient proposer d’ouvrir des ateliers dans le ghetto pour les faire profiter d’une main-d’œuvre quasi gratuite.
C’est ainsi que vont prospérer les ateliers Toebbens, qui emploient début 1943 près de 15 000 ouvriers, les ateliers Schultz, et les ateliers de brosserie. Convaincus qu’une place de travail vaut sauf-conduit, les captifs sont totalement soumis. Après la « grande déportation », les patrons se contentent de fournir quotidiennement au travailleur 500 grammes de pain et deux litres de soupe, et de verser 5 zlotys par jour et par tête à la SS, « propriétaire » de la main-d’œuvre.
A. Le travail obligatoire
Au cours des premiers jours de l’occupation de la Pologne, les Allemands raflent en pleine rue des passants juifs pour les contraindre, sur-le-champ, à travailler pour eux sans rémunération. La pratique du travail forcé terrifie la rue juive. En janvier 1940, tous les hommes juifs âgés de 13 à 59 ans sont contraints de s’inscrire pour le travail forcé. 121 265 personnes sont enregistrées en quelques semaines.

Un homme se jette dans le vide du haut d'un immeuble. (Photo prise par les S.S. qui indiquent en légende "Bandit qui se suicide pour éviter l'arrestation")
B. La fin du ghetto de Varsovie
Entre juillet et la mi-septembre 1942, les Allemands déportèrent au moins 300 000 Juifs du ghetto de Varsovie. Pour les 40 000 qui restaient dans le ghetto, la déportation semblait inéluctable.
Plusieurs organisations juives créèrent une unité de défense armée, l'Organisation juive de combat (OJC ou Zydowska Organizacja Bojowa - ZOB). Le Parti révisionniste (les sionistes de droite) fonda une autre organisation de résistance, l'Union combattante juive (Zydowski Zwiazek Wojskowy - ZZW). Bien qu'au départ il existât certaines tensions entre ces deux organisations, elles décidèrent en fin de compte de combattre ensemble contre les nouvelles déportations.
Les Allemands tentèrent de reprendre les déportations des Juifs de Varsovie en janvier 1943. Un groupe de combattants juifs s'infiltra dans un groupe de Juifs que l'on dirigeait vers l'Umschlagplatz (point de rassemblement) et, à un signal donné, se jeta sur les gardes allemands. Après avoir pris entre 5 000 et 6 500 résidents du ghetto, les Allemands interrompirent les déportations. Encouragés par le succès apparent de la résistance, l'arrêt des déportations, les habitants du ghetto commencèrent à bâtir des abris souterrains (qu'ils nommèrent "bunkers") en préparation d'une révolte, au cas où les Allemands entameraient la déportation finale. Les Allemands avaient l'intention de commencer à déporter les Juifs restants dans le ghetto de Varsovie le 19 avril 1943, le soir de la Pâque juive. Lorsqu'ils entrèrent ce jour-là dans le ghetto, les rues étaient vides. La reprise des déportations constitua le signal d'une révolte armée. Bien que les Allemands soient rapidement venus à bout de la résistance militaire, des individus et de petits groupes continuèrent à se cacher et à combattre les Allemands jusqu'au 16 mai 1943. La révolte du ghetto de Varsovie fut la première révolte urbaine et symboliquement la plus importante de l'Europe occupée.
Le commandant de l'OJC, Mordekhaï Anielewicz, dirigea les forces de la résistance dans la révolte du ghetto de Varsovie. Le troisième jour de la révolte, des forces blindées commandées par le général SS Jürgen Stroop commencèrent à incendier le ghetto, un immeuble après l'autre, pour faire sortir les Juifs de leurs cachettes. Les combattants effectuaient des raids sporadiques, mais les Allemands réduisirent systématiquement le ghetto en ruines. Anielewicz et ses amis furent tués lors d'une attaque de leur bunker, le 8 mai.
Le 16 mai 1943, Stroop ordonna la destruction de la Grande synagogue de la rue Tlomacki, pour symboliser la victoire allemande. Du ghetto il ne restait que des ruines. Stroop rapporta avoir capturé 56 065 Juifs et détruit 631 abris. Il estima que ses unités avaient tué 7 000 Juifs durant la révolte. Environ 7 000 autres furent déportés à Treblinka, où ils furent exterminés. Les Allemands déportèrent les Juifs survivants dans les camps de travail de Poniatowa, de Trawniki et de Majdanek.
Les Allemands avaient prévu de liquider le ghetto de Varsovie en trois jours mais les combattants juifs réussirent à tenir plus d'un mois.

Des Juifs capturés sont alignés contre le mur du ghetto. Au fond, une des portes du ghetto.
On remarquera qu'il s'agit presque exclusivement d'adultes. Pour la plupart, les enfants avaient déjà été pris.
7000 juifs furent exécutés sur place, 6000 autres périrent dans les incendies et la destruction du ghetto,

Des Juifs capturés durant l'insurrection sont emmenés vers la "Umschlagplatz" (voir plan ci-dessus) dans un ghetto en flammes.
CONCLUSION
Le ghetto de Varsovie fut créé en 1940 et pratiquement détruit en mai 1943. Plus de 7 000 Juifs furent tués pendant la liquidation du ghetto. 7 000 furent assassinés à Treblinka et 42 000 autres furent déportés vers des camps de concentration et de travail forcé du district de Lublin. Seuls 80 combattants du ghetto survécurent et certains d’entre eux trouvèrent la mort lors de l’insurrection de Varsovie de l’été 1944.
En juillet 1943, les Allemands installent un petit camp de concentration où ils transfèrent 3 000 Juifs d’Auschwitz afin de récupérer ce qui peut l’être et déblayer les ruines : il ne doit rien rester du ghetto de Varsovie et du judaïsme polonais.